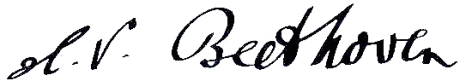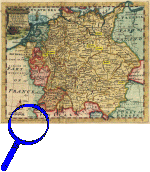|
|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
1770 |
Ludwig van Beethoven est baptisé le 17 décembre dans sa
ville natale de Bonn* sur le Rhin (Allemagne). La date exacte de sa
naissance n’est pas connue mais elle est probablement le 16 décembre.
*Les lieux marqués en couleur sont indiqués sur la carte de l’Allemagne ci-jointe. Leurs noms tels qu’ils paraissent sur la carte sont donnés entre parenthèses. Il est le premier enfant survivant de Maria Magdalena vB, née Keverich, et de Johann vB, musicien (ténor et violoniste) mal payé à la résidence de Bonn de Maximilian Friedrich, Prince-Électeur et Archevêque de Cologne. Le nom van Beethoven indique que la famille est originaire de Flandre (aujourd’hui en Belgique); l’attribut van n’en est pas un de noblesse. Son grand-père Ludwig vB sénior était un chanteur respecté (bassiste) à la même cour, lui aussi avec un piètre salaire même comme chef d’orchestre mais tirant un revenu comme marchand des vins et d’autres commerces. |
|
1773 |
Décès du grand-père bien aimé. | |
1775 |
Lešons de musique par le père stricte; pour jouer du piano, le petit Ludwig doit se tenir debout sur un escabeau. À cette époque, il n’est pas encore obligatoire d’aller à l’école et puisque ses parents n’insistent pas qu’il y aille de fašon régulière, LvB sera affecté toute sa vie de lacunes, principalement en mathématiques. | |
1778 |
Première présentation de LvB, à Cologne, dans sa relativement brève carrière de Wunderkind, toujours avant son huitième anniversaire, avec un programme de musique de piano. Il est déjà connu pour ses talents d’improviser de la musique sur un thème donné. | |
1782 |
Sur l’instigation de son professeur de musique Christian
Gottlob Neefe, Ludwig publie ses premières compositions, des Variations
sur une marche de Dressler (WoO 63, en ut mineur) chez Goetz, un éditeur
à Mannheim. Neefe lui apprend, entre autres, les règles de contrepoint, et
Ludwig le remplace de temps en temps comme organiste dans l’orchestre à la
cour.
*Beethoven attribue des numéros à ses oeuvres selon leur importance et selon des critères que nous ne connaissons pas, en tout cas non pas dans un ordre chronologique. Approximativement la moitié de ses compositions n’est pas ainsi marquée et porte donc la désignation WoO (allemand pour «Oeuvre sans numéro d’opus»). |
|
1783 |
Neefe écrit dans le Magazin der Musik de Hamburg sur la virtuosité du jeune Beethoven au piano et il mentionne sa prédilection pour le Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach. Publication des trois Sonates pour Piano (WoO 47). | |
1784 |
Beethoven obtient de la part du Prince-Électeur Maximilian
Franz, successeur de Maximilian Friedrich, la position salariée à la cour
d’un organiste remplašant. Il joue l'alto, le violon et le violoncelle à
part des instruments à clavier. Son salaire soulage la situation financière de plus en plus pénible des ses parents et de ses frères Caspar Anton (né en 1774) et Nikolaus Johann (né en 1776). Le père perd sa voix ainsi que sa réputation professionnelle et s’adonne à l’alcool. |
|
1786 |
L’artiste-portraitiste Johann Peter Lyser mentionne avoir remarqué pour la première fois lors d’une visite chez des amis que Ludwig van Beethoven avait des troubles d’ou´e. | |
1787 |
Au printemps, LvB se met en route pour Vienne (Vienna) en voyage d’étude, mais il se voit obligé de rentrer après juste trois semaines à cause d’une maladie grave de sa mère; elle meurt en juillet d’une tuberculose. Maria Margaretha (née en 1786), la petite soeur de Ludwig, meurt en novembre. | |
1789 |
LvB s’inscrit à l’Université de
Bonn, probablement en
philosophie, esthétique et littérature – mais il n'attend les cours
probablement non pas de fašon régulière. Il acquiert une formation
intellectuelle de laquelle il est fier. Il lit beaucoup et connaît, par
exemple, Les souffrances du jeune Werther de Johann Wolfgang Goethe
(publié en 1774), une des oeuvres des plus modernes à l’époque, ainsi que la
première version de l’Ode a la joie de Friedrich Schiller (publiée en
1785).
Le Prince-Électeur donne suite à la pétition de Ludwig et ordonne que la moitié du salaire de Beethoven père soit dorénavant payée à l’organiste à la cour Ludwig van Beethoven. Le père est mis a la retraite et le fils devient officiellement le chef de famille. |
|
1792 |
LvB obtient une bourse de la part du Prince-Électeur pour
entreprendre des études à
Vienne qui est à l’époque un des centres de la
musique des plus importants, et spécificiquement pour étudier chez Joseph
Haydn. Son ami le comte Ferdinand Graf Waldstein lui écrit dans son journal
personnel les mots d’adieux célèbres, qu’il «recevra, de par sa diligence,
l’esprit de Mozart des mains de Haydn».
Beethoven prend une chambre sous le toit de l’édifice dans lequel le Prince Karl von Lichnowsky occupe tout un étage. Ce riche propriétaire de terres en Silésie est un excellent pianiste, a pris des lešons chez Wolfgang Amadeus Mozart et employe un quatuor à cordes dont le violoniste primaire, Ignaz Schuppanzigh, deviendra bientôt l’ami de LvB. Ludwig rešoit la triste nouvelle, seulement quelques semaines après son arrivée a Vienne, que son père Johann était décédé à l’âge d’à peu près 52 ans |
|
1793 |
Ludwig Fischenich, professeur de littérature antique à
l’Université de Bonn, écrit à Charlotte Schiller que LvB a l’intention de
mettre en musique l’Ode à la joie de Friedrich Schiller. L’ode
deviendra le thème principal du mouvement final de la Neuvième Symphonie
en 1823.
Beethoven fait rapidement la connaissance d’un grand nombre des meilleurs musiciens à Vienne par sa virtuosité au piano et il entre vite dans les plus hauts cercles de la société viennoise. Il n’est pas satisfait des lešons de Haydn qu’il considère négligent et prend en cachette un cours de composition chez Georg Albrechtsberger. Ignaz Schuppanzigh lui donne des lešons de violon et Antonio Salieri lui montre ce qui est le style italien moderne. Une jeune femme, étudiante de piano chez LvB, le décrit comme étant de petite taille et de peu d’apparence (il a 1,68 m), d’un visage laid et grêlé, de cheveux foncés,et qui ne s’habillait pas comme le demandait la haute société. En tout cas, Beethoven ne porte jamais de perruque allongée comme le fait Joseph Haydn par exemple. |
|
1794 |
Le Prince Lichnowsky est maintenant un des ses meilleurs amis et le supporte d’un salaire généreux après que le Prince-Électeur Maximilian Franz eut cessé ses paiements suite a l’occupation de Bonn par les Franšais. | |
1795 |
Beethoven s’applique au travail avec zèle. Il écrit un
grand nombre d’oeuvres remarquables, joue souvent aux soirées de Lichnowsky,
rešoit de plus en plus d’invitations et gagne un très bon revenu comme
artiste indépendant. Les frères Caspar et Nikolaus viennent également
s’établir à Vienne. C’est probablement dans cette période de sa vie qu’il se
décide de rester a Vienne pour de bon. Lors de sa première apparition publique à Vienne le 29 mars, Beethoven présente son Concerto pour piano en ut majeur, op. 15. |
|
1796 |
Voyage à Prague, Dresde, Berlin et Leipzig (Leypzig). | |
1798 |
Des amis et connaissances de LvB observent dès cette année
sa difficulté d’ou´e croissante. Il se plaint lui même de bourdonnements et
de douleurs périodiques dans les oreilles. Création (parmi beaucoup d’autres oeuvres) de la Sonate pathétique, en ut mineur, op. 13. |
|
1800 |
Première représentation, le 2 avril, de la Symphonie no. 1 (en ut majeur, op. 21) dans le Burgtheater de Vienne. Avant avoir terminé la trentième année de sa vie, il est reconnu et même célèbre comme artiste indépendant, virtuose, génial improvisateur et compositeur. | |
1801 |
LvB écrit à son ami de jeunesse, le médecin Franz Gerhard Wegeler, et demande son opinion concernant le galvanisme comme traitement pour sa surdité, traitement tout nouveau à l’époque et en vogue utilisant un courant électrique contre toutes sortes de maladies. | |
1802 |
Beethoven rédige le soi-disant Testament de
Heiligenstadt lors d’un séjour d’été dans ce village près de
Vienne. Il
l’adresse à ses frères mais ne l’envoie pas; on le trouve seulement après sa
mort. Dans ce document, il excuse ses manières brusques par la situation
désespérante de sa surdité et il écrit que seulement son art l’avait empêché
de se suicider. Il remercie ses amis et son médecin, assure qu’il endurera
sa «misérable vie» jusqu’à sa fin naturelle et qu’il légue sa «petite»
fortune à ses frères. Ainsi, le Testament n’est pas une lettre
d’adieux d’une personne songeant au suicide. La sonate Au clair de lune en ut dièse mineur, op. 53, est créé. Beethoven la dédicace à la jeune Comtesse Giulietta Guicciardi, une des ses étudiantes de piano; il est assez souvent l’invité bien rešu chez ses parents. Composition coquine Flatterie du gros (WoO 100) pour son ami et violoniste exceptionnel Ignaz Schuppanzigh. |
|
1803 |
Première (entre autres) de la Symphonie no. 2 (en ré majeur, op. 36), du Concerto pour piano no. 3 (en ut mineur, op. 37) et de la Sonate pour piano en la majeur, op. 47, qui sera plus tard dédicacée au violoniste Rodolphe Kreutzer et sera connue par son nom. | |
1805 |
Beethoven courtise la veuve Josephine Brunswick-Deym.
Première présentation de la Symphonie no. 3, en mi bémol majeur, op. 55 (Héro´que) et de l’opéra Fidelio (op. 72) dans sa première version, les deux au Theater an der Wien. Le Fidelio rešoit un accueil plutôt froid. Il souffre fréquemment de coliques intestinales, et sans un régime stricte ni les eaux minérales ni des cures balnéaires peuvent améliorer la situation. L’auteur dramatique Franz Grillparzer dépeint le compositeur, dans ses Souvenirs de Beethoven (publiés en 1844) comme homme «maigre, habillé à la dernière mode» et portant des lunettes. |
|
1806 |
Composition de trois Quatuors à cordes, op. 59, pour le Comte (plus tard Prince) André Rasumowsky, qui est l’ambassadeur russe à la cour de Vienne et un bon violoniste. | |
1807 |
Pendant ce temps Beethoven change d’apparence. Selon Grillparzer, il est devenu plus fort dans les deux années passées et néglige ses vêtements au point de paraître malpropre. | |
1808 |
Un panaris, i.e. une inflammation purulente d’un doigt de la main gauche (?), est opéré; il n’est heureusement pas handicapé au piano de fašon permanente. | |
1809 |
Beethoven traverse des crises profondes avec des idées de suicide à cause de son «inflammation intestinale» et de sa surdité progressive. Malgré cela, il espère toujours pouvoir trouver une épouse. Il s’éprend de la jeune Therese Malfatti qui est la nièce de son médecin et a seulement 19 ans; il se fait faire des complets à la mode et des nouvelles chemises et ainsi reprend soin de son apparence. | |
1810 |
LvB demande à un de ses amis de Bonn de lui envoyer un
certificat de baptême; il a apparament des visées de mariage avec Therese.
Malheureusement, elle repousse ses avances. La joyeuse et exaltée Bettina Brentano qui se faisait déjà remarquer par Goethe pour son intelligence – et que le poète trouve agašante plus tard – cherche la compagnie de Beethoven et il y a des indices qu’il s’intéresse à elle. |
|
1811 |
Séjour de cure balnéaire à Teplitz au nord-ouest de Prague (aujourd’hui Teplice, Tchétchénie). Amélioration temporaire de ses douleurs aux oreilles. | |
1812 |
À nouveau, séjours dans des stations balnéaires, à Teplitz
et ailleurs. Plusieures rencontres avec Johann Wolfgang Goethe qui est
devenu un admirateur de Beethoven depuis l’adaptation musicale de son drame
Egmont («...son talent m’a étonné...»), mais qui le considère une
personnalité farouche. En juillet, Beethoven écrit une lettre d’amour des mieux connues dans la littérature allemande, la Lettre à son immortelle bien-aimée. Il ne divulge pas le nom de la dame dont l’identité demeure à toujours une énigme Le buste bien connu de LvB est formé par le sculpteur Franz Klein d’après un masque du visage et est considéré un témoignage fidèle. |
|
1813 |
Aucun de la multitude d’audiophones genre cornet qu’il a en
sa possession l’aide. Il est continuellement à la recherche d’un appareil
efficace. Ceci démontre la profondeur de sa surdité et de son désespoir: par
example, il tient une tige en bois entre les dents, touchant par le bout
libre la plaque de résonance du piano afin d’entendre les tons par
conduction osseuse.
Ses compositions font preuve, comme toujours, de son art génial et de sa vigueur d’expression, mais sa virtuosité est en déclin. Son tableau de bataille La victoire de Wellington (op. 91) a sa première le 8 décembre; cette composition sera le plus grand succès de toutes ses oeuvres pendant sa vie. La situation financière de Beethoven est mauvaise malgré des revenus suffisants ou même bons. Son ménage est en désarroi total. Il a un comportement brusque et repoussant; il accuse souvent ses employés de maison de malhonnêteté. Sa timidité et sa méfiance s’expliquent certainement par la surdité. Le Prince Ferdinand Bonaventura Kinsky meurt, un de ses amis et mécènes dans le cercle de noblesse qui lui verse des fonds depuis des années. |
|
1814 |
Le tout premier de ses mécènes, le Prince Karl v. Lichnowsky, décède également. Il était son ami dès son arrivée à Vienne. | |
1815 |
Le Congrès de Vienne commence ses délibérations concernant le
nouvel ordre de l’Europe suite aux guerres Napoléoniques. Beethoven offre
ses salutations à la nouvelle Europe avec la cantate joyeuse et optimiste
(op. 136) Le moment glorieux. Le 25 janvier il donne un concert en
l’honneur de la tsarine; il est son dernier.
Ludwig perd son frère cadet Caspar Anton, appelé Carl, vers la fin de l’année; il était devenu un professeur de musique compétent et recherché. Beethoven est désigné tuteur de son neveu Karl, partageant cette responsabilité avec la mère de Karl, Johanna. Les dépenses de la veuve menacent d’épuiser l’avoir du défunt, et Beethoven se voit impliqué dans un procès juridique qui durera de longues années et demandera beaucoup de son énergie. Néanmoins, il s’occupe de fašon consciencieuse de la formation de son neveu, particulièrement de son éducation en musique qui sera fournie par, entre autres, son ancien élève Karl Czerny. |
|
1817 |
Beethoven est insatisfait des thérapies préscrites par son
médecin Johann Malfatti puisqu’il ne ressent toujours pas d’amélioration de
son état de santé. Il faut dire qu’il suit à peine les ordonnances
médicales.
Il a pris l’habitude de boire à peu près 1 litre de vin de table par jour, une quantité qui n’est pas considérée excessive à l’époque. Les ordonnances des médecins suivant le docteur Malfatti lui interdisent toute consommation d’alcool. |
|
1819 |
Beethoven utilise des cahiers de conversation dès le mois
de janvier de cette année, et toute causerie sera donc tenue par écrit. Les
visiteurs écrivent leurs questions et propos dans le cahier; les réponses ou
contributions de LvB ne sont évidemment pas disponibles. 120 de ces cahiers
existent toujours.
Essentiellement continuation du travail à la Missa solemnis que Beethoven a commencé à écrire au cours de l’année précédente. |
|
1821 |
Beethoven présente une jaunisse au début de juillet, le
symptôme d’une maladie dans laquelle les cellules du foie sont détruites par
l’action de toxines ou par infection menant au dépôt, dans la peau, d’un
colorant jaune provenant de l’hémoglobine. Il se rétablit en quelque sorte
en novembre pour «...vivre de nouveau pour mon art ce qui n’a pas été le
cas depuis deux ans...».
Il a toujours un teint jaune ce qui laisse penser qu’il souffre d’une maladie chronique du foie, donc d’une cirrhose. |
|
1822 |
La cêlèbre soprano Wilhelmine Schröder-Devrient écrit dans
ses mémoires que Beethoven confondait totalement le choeur et l’orchestre et
les faisait perdre la mesure lorsqu’il conduisait la répétition finale du
Fidelio, «...le visage dérangé mais les yeux divinement passionnés...»
Il aurait été navrant de le voir assis, tout résigné, derrière l’orchestre
lors du concert. Cette fois, le Fidelio se montre un grand succès.
Anton Schindler, un musicien accompli, devient secrétaire et factotum de Beethoven; il ne rešoit aucun salaire pour ses services. LvB le traite très mal et l’accuse, par exemple, de s’être approprié le revenu d’un concert. Schindler publiera, en 1840, une biographie de Beethoven qui pourtant contient un nombre d'erreurs grossières |
|
1823 |
La Missa solemnis (op. 123) et les Variations sur
un thème de Diabelli (en ut majeur, op. 120) sont terminées.
Beethoven souffre, de janvier à août, d’une douloureuse conjonctivite aux deux yeux. |
|
1824 |
Première présentation de Kyrie, Credo et Agnus Dei de la Missa solemnis ainsi que de la Symphonie no. 9 (en do mineur, op. 125) au Kärntnertor-Theater de Vienne. Le compositeur ne peut plus entendre les applaudissements enthousiastes. | |
1825 |
A partir de cette année, la biographie de Beethoven devient presqu’exclusivement une chronique de ses maladies. Son état de santé empire. Ses troubles digestifs le font souffrir, il a souvent des coliques dans l’intestin et il rapporte avoir du sang dans les selles et dans les expectorations. Tous ces symptômes sont probablement la conséquence de la maladie chronique du foie. S’y ajoutent la douleur aux yeux et, tout récemment, des douleurs du type arthrite qui lui font mal lorsqu’il marche. | |
1826 |
En novembre, lors de très mauvais temps, LvB rend visite à
son frère Johannes qui est devenu pharmacien et riche propriétaire foncier,
à son domaine à Krems sur le Danube. Johannes remarque dans son journal
personnel que Ludwig a un ventre très gonflé.
Au voyage de retour de chez son frère, Beethoven prend froid, développe de la fièvre accompagnée de frissons et de points de côte, et il a du mal à respirer. Son médecin, maintenant le professeur Ignaz Andreas Wawruch, établit le diagnostic d’une pneumonie et il réussit à guérir cette maladie souvent mortelle à l’époque. Beethoven a le ventre gonflé à cause d’une accumulation de liquide dans la cavité abdominale. La perte de cellules de foie fonctionnelles qui avait commencée avec l’apparition d’une jaunisse quelques années auparavant produisait une cicatrisation du foie, donc une cirrhose. Ceci a comme conséquence une congestion du sang dans les vaisseaux sanguins menant au foie, puis sortie du fluide sanguin des vaisseaux et finalement accumulation de ce fluide dans le ventre, i.e. développement du soi-disant ascite. Le professeur Wawruch doit faire plusieures ponctions de l’abdomen et prélève à une de ces occasions un volume pesant 25 livres (donc à peu près 13 kg !). Cette procédure purement symptomatique, entreprise sans anesthésie, apporte seulement un soulagement temporaire. |
|
1827 |
Beethoven rédige son testament le 3 janvier. Son neveu Karl est le héritier universel. Ludwig van Beethoven perd conscience le 25 mars. Il meurt dans un coma de foie le 26 mars vers 17h45, dans sa cinquante-sixième année. Une autopsie est faite le jour suivant. Beethoven est enterré au cimetière de Währingen, le 29 mars. Franz Grillparzer donne l’eulogie aux funérailles. |
|
1863 |
Première exhumation du corps de LvB; suite à un examen pathologique, il est ré-enterré dans un cercueil en métal. | |
1888 |
Deuxième exhumation, examen pathologique et transfert du cercueil à un tombeau d’honneur au cimetière central de la ville de Vienne. | |
|
Le protocole (rédigé en latin) de l’autopsie fut découvert à nouveau en 1970, dans une pile de vieux documents. Le rapport médical décrit l’apparence typique d’une cirrhose du foie et confirme le diagnostic des médecins traitants. La cause directe de la mort était donc une défaillance du foie suite à une cirrhose. Pour examiner l’organe de l’ou´e, on a prélevé et préservé quelques petites parties de l’os temporal des deux côtés du crâne. Ces fragments furent considérés comme reliques précieuses par la famille d’un professeur de l’historique de la médecine mais remis, en 1985, aux professeurs de médecine à l’Université de Vienne Hans Bankl et Hans Jesserer, pour fin d’examen. Ces deux scientifiques publiaient en 1987 un livre sur les maladies de Beethoven présentant la conclusion, entre autres, que sa surdité n’avait pas été causée, comme on l’avait longtemps pensé, par l’ostéite déformante et hypertrophique de Paget. Une syphilis fut également exclue comme cause. Les auteurs offrent l’explication qu’il s’agissait d’une otosclérose de l’oreille interne, une dégénérescence relativement rare du nerf acoustique provoquée par une lésion des vaisseaux sanguins l’accompagnant. Ce diagnostic est parfaitement conforme avec les symptômes et la progression des troubles d’ou´e de Beethoven. Concernant la myopie de Beethoven: la mesure de réfraction des lentilles dans deux des lunettes de Beethoven, d’un monocle et d’une loupe donnait des valeurs entre -1.75 et -4.0 dioptries. Le degré précis de sa myopie ne peut pas être déterminé parce qu’on ne sait pas à quel âge il a utilisé ces lunettes et parce qu’un empirement ou une amélioration de la vision avec l’âge sont possibles. Une curiosité: Beethoven avait presque toutes ses dents à sa mort, ce qui était plutôt rare à l’époque. |
||
Lecture recommandée |
||
|
Bankl, Hans; Jesserer, Hans: Die Krankheiten Beethovens. Verlag Wilhelm Maudrich, Wien: 1987 (en allemand) Beethoven Bicentennial Collection (enregistrements) George G. Daniels, ed., Time Inc., New York: 1972 (en anglais) Geck, Martin: Ludwig van Beethoven. Rowohlt-Verlag, Reinbek, 5. Aufl.: 2001 (en allemand) Grillparzer, Franz: Sämtliche Werke. Carl Hauser, München: 1965, Bd. IV, pp. 195-203 (en allemand) Kaiser, Joachim: Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten. S. Fischer, Frankfurt/Main: 1975 (en allemand) Kinsky, Georg; Halm, Hans: Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis aller vollendeten Werke Ludwig van Beethovens. G. Henle, München: 1955/83 (en allemand) Schindler, Anton: Biographie von Ludwig van Beethoven. Faksimile-Nachruck der Ausgabe von 1871. Georg Olms Verlag, Hildesheim: 1994 (en allemand) Schmidt, Leopold: Beethoven, Werke und Leben. Wegweiser-Verlag, Berlin: 1924 (en allemand) Solomon, Maynard: Beethoven. Schirmer Books, New York: 1998 (en anglais) Uhde, Jürgen: Beethovens Klaviermusik. Reclam, Stuttgart: 1984 (en allemand) |
||